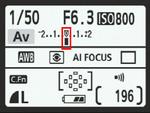L'exposition
C'est la quantité de lumière reçue par
le capteur.
La quantité de lumière nécessaire dépend de la sensibilité
choisie, et est déterminée par la mesure de la lumière
réfléchie TTL (Through The Lens : à travers
l’objectif).
Tous les appareils numériques actuels intègrent
un posemètre permettant cette mesure TTL.
Ce type de posemètre, du fait de son positionnement, mesure la lumière
exacte passant à travers l’objectif, d’où une plus
grande précision que s’il était placé à l’extérieur.
De plus, afin d’affiner sa mesure et pour répondre à de
multiples situations, il est souvent associé aux trois procédures
de mesure suivantes : pondérée centrale, matricielle
(multi-zones), spot.
| La sensibilité |
Elle exprime la sensibilité à la quantité
de lumière présente.
Tout comme les films argentiques les capteurs photosensibles
sont calibrés pour une sensibilité ISO,
définie par la norme ISO 5800/1987 qui a remplacé l’ancienne
norme ASA. La valeur ISO est représentée
par les nombres suivants :
ISO 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200
| 6400...
Chaque nombre représente deux fois la sensibilité
du précédent.
Tout capteur possède une sensibilité de
base, dite « native », qui est 100 ou 200 ISO. Plus la valeur
ISO de base est élevée, plus le capteur d'image est sensible
et plus on pourra utiliser une ouverture de diaphragme petite ou une durée
d’exposition courte.
L'augmentation de la sensibilité ne modifie
absolument pas la capacité du capteur lui-même,
mais permet à l’électronique embarquée d’accepter
des signaux plus faibles issus du capteur en les amplifiant.
Ainsi le passage de 200 à 400 ISO permettra pour une luminosité
deux fois moins forte de garder le même couple diaphragme/vitesse
ou pour une même luminosité, soit de fermer le diaphragme
d’un cran (passage de f/5,6 à f/8) pour augmenter la profondeur
de champ, soit de diviser par deux la durée d’exposition
(on dit doubler la "vitesse": passage de 1/60 s à
1/125 s), pour saisir un mouvement.
Cette augmentation de la sensibilité apparente
du capteur, du fait de l’amplification électronique qu’elle
impose aux signaux électriques, va générer du bruit
dans l’image sous forme de pixels erratiques, bleus, verts ou rouges,
plus ou moins groupés, surtout dans les parties sombres.
Ceci de façon d’autant plus importante que la valeur ISO
choisie est grande.
Le bruit généré dépend, à nombres de
pixels identiques, de la taille des
photosites.
|
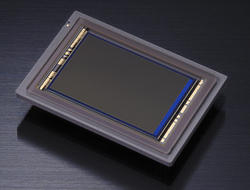
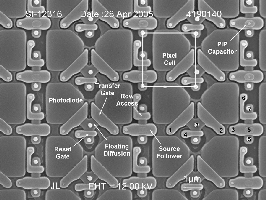
|
| La
mesure pondérée centrale |
La mesure est faite sur l’ensemble
du champ cadré, mais avec prépondérance du centre
dans une proportion et une étendue données, dépendant
de chaque fabricant, et modifiable sur certains boîtiers. Sur le
terrain elle se montre assez efficace dans la plupart des situations de
prise de vues : sujets pas trop contrastés.
En revanche avec certains éclairages difficiles
comme le contre-jour, ou trompeurs comme les paysages de neige ou une
scène sombre, il est prudent de débrayer l’automatisme,
ou d’utiliser le correcteur d’exposition,
le bracketing, ou d’utiliser la mesure
matricielle.
|
| La mesure matricielle |
Ce type de mesure très élaborée
met en jeu à chaque sollicitation une multitude de mesures simultanées
sur la presque totalité du champ visé. L’image est découpée
en de nombreuses zones et chaque zone est donc mesurée de
façon indépendante. Ce type de mesure nécessite
un calculateur assez puissant pour traiter les multiples mesures obtenues
et les comparer à une multitude de cas de figures possibles contenus
dans une gigantesque base de données.
Sur les Nikon D2x, D200 et D700 par exemple (et plus tôt encore
sur le F5), le posemètre qualifié de "3D couleur"
est constitué d'un capteur RGB de 1005 pixels (ou zones de mesures)
mesurant environ 1 cm2 dont la tâche
consiste à évaluer la couleur et l'intensité lumineuse
du sujet. Chaque image est évaluée en tenant compte de 7
paramètres comprenant la brillance, la couleur, le contraste, la
zone de mise au point et la distance du sujet. Cette évaluation
se réfère à une base de données intégrée
qui reprend les paramètres de plus de 30000 images réelles
! Ainsi, si un crépuscule et un ciel couvert par exemple présentent
la même luminosité, le capteur se basera sur la couleur et
éventuellement la distance pour optimiser le temps d'exposition
pour chaque situation.
Ce type de mesure convient à plus de 90%
des cas. On peut donc lui faire confiance. Pourtant dans certains cas
extrêmes (sujets très contrastés, clairs sur fond
noir, ou à fort contre-jour), il est difficile d’obtenir
la densité souhaitée pour une zone donnée du sujet.
Seule une mesure de la lumière sur une zone restreinte du sujet
est efficace dans ce cas.
|
| La mesure spot |
Contrairement aux deux autres mesures, la mesure
spot n’analyse qu’une zone très réduite
de l’image : de 1 à 3 % de sa surface totale. Cette
zone limitée est repérée dans les viseurs par un motif
gravé (petit cercle ou carré). Cette mesure est plus délicate,
car il faut déterminer la zone du sujet à mesurer et savoir
interpréter le résultat.
Cette mesure est intéressante à utiliser pour les sujets
à forts contrastes d’éclairage. Elle permet de déterminer
les écarts de luminosité entre les différentes zones
du sujet et de choisir la zone que l’on veut privilégier.
|
Les modes d'exposition
Il convient donc de régler, outre la sensibilité,
l'ouverture et la vitesse.
Cela se fait en choisissant l'un des modes suivants :
| Auto |
Entièrement automatique |
 |
| P |
Program. Le système chisit un couple ouverture/vitesse
adapté à la focale. |
| A |
Aperture. Mode "Priorité à l'ouverture"
: on choisit l'ouverture (cf. diaphragme)
; le système règle la vitesse. |
| S |
Speed. Mode "Priorité à la vitesse"
: on choisit la vitesse (cf. obturateur)
; le système règle l'ouverture. |
| M |
Manual. On règle tout soi-même. |
L'indice de lumination (IL ou EV) et
le couple diaphragme/vitesse
En photographie, l'indice de lumination mesure la quantité
de lumière devant parvenir au capteur pour aboutir à une exposition
correcte. Il se traduit par un triplet (sensibilité, ouverture de diaphragme,
vitesse d'obturation). L'indice de lumination zéro (IL = 0) correspond
à 100 ISO, f/1 et 1 seconde. Un changement de valeur dans ce triplet
correspond à un changement de lumination, et inversement.
A chaque fois qu'on divise la sensibilité par deux, cela
correspond à l'augmentation d'un indice de lumination (+ 1IL) et inversement.
A chaque fois qu'on ferme le diaphragme d'une valeur, cela correspond
à l'augmentation d'un indice de lumination (+ 1IL) et inversement.
A chaque fois qu'on divise la durée d'exposition par
deux, cela correspond à l'augmentation d'un indice de lumination (+ 1IL)
et inversement.
A un indice de lumination donné on peut faire
correspondre plusieurs couples « vitesse/diaphragme » pour une sensibilité
donnée.
En mode Programme, il est possible de changer le couple vitesse/diaphragme
afin de donner une plus grande importance soit à la vitesse, soit à
l'ouverture, sans pour autant changer l'exposition.
Dans la table suivante, tous les couples procurent la même exposition
:
| 1/60 |
1/125 |
1/250 |
1/500 |
1/1000 |
1/2000 |
| F/11 |
F/8 |
F/5,6 |
F/4 |
F/2.8 |
F/2 |
La correction
d'exposition
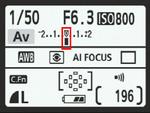 |
La plupart des appareils permettent de corriger l'exposition
sur une échelle de -2 IL à +2 IL, par tiers.
En cas d'incertitude, on peut recourir au "bracketing".
Ce mode utilisé dans des conditions difficiles de prises de vues
(par exemple en présence de trop peu de lumière ambiante
ou trop de réverbération) permet d'entourer les valeurs
nominales d'exposition par des valeurs légèrement décalées
d'ouverture ou de vitesse, variant par tiers entre +2 (surexposition)
et -2 (sous-exposition) IL. |
Remarque
Lorsqu'un faisceau de lumière recontre un orifice de
petite taille, une petite partie de ce faisceau est diffusée dans toutes
les directions par les bords de l'orifice. Ces ondes diffusées interférent
ensuite entre elles. Ce phénomène est appelé diffraction.
C'est la raison pour laquelle il vaut mieux éviter de fermer
le diaphragme au maximum.
accueil | matériel
| prise de vue | post-traitement
| diffusion | index
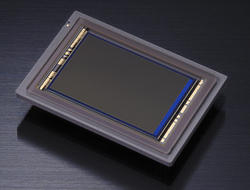
![]()